Entre nous (81)
J'ai revu un ex, un de ceux du lointain passé,
dans un café, place de la Madeleine. Je
l'ai reconnu à sa démarche quand il a traversé
pour me rejoindre, à la sortie du métro. C'est curieux, une démarche,
ça ne s'oublie pas. La sienne, autrefois, alors qu'il avait la trentaine à peine, était déjà lourde et légèrement claudicante, quelque chose en elle de nonchalant
aussi... J'ai vu qu'il ne portait plus la barbe et arborait un costume trois-pièces de la maison de prêt à porter de luxe (d'où le lieu de notre
rendez-vous) pour laquelle il travaille à présent, "après des années de galère", m'a-t-il dit d'emblée. Je l'ai reconnu de loin à
sa démarche, puis quand il m'a
embrassée, à son odeur. C'est très étonnant. Vingt ans après, à moins qu'il n'ait pas changé
d'eau de toilette pendant tout ce temps, auquel cas ce que je crois reconnaître ne serait que son parfum, c'est son odeur à lui sui generis qui "parle" à mes neurones, via les sensations, celle que j'ai retrouvée dans la seconde, instantanément,
et avec, tout un tas de souvenirs qui y sont associés que je croyais avoir oubliés...
Il m'a
dit en prenant place en face de moi qu'il avait le trac. Moi, pas. Me
sentais simple visiteuse. Du passé ? D'une autre vie ? J'ai
remarqué qu'il avait toujours ses yeux
rougis et globuleux, comme autrefois. Je me suis demandé si durant toutes ces années
"de galère", il n'avait pas un
peu forcé sur la picole et le tabac...
En deux heures, il a consommé deux bières, les enchaînant. Une à la pression ("pas assez fraiche") et une autre
en bouteille. Je l'ai empêché de fumer un cigare car il faisait vraiment trop chaud et
j'ai commandé pour ma part un Vittel-menthe
(la détente d'un verre de blanc, dans
ce moment-là, tendu, n'était pas de mise) en me demandant ce que je faisais là, avec cet homme que je n'avais pas spécialement aimé jadis mais avec qui j'avais partagé, à un moment de ma vie, quelque
chose d'assez indéfinissable : nos deux détresses conjuguées, probablement...
Cela
faisait rien moins que vingt-trois ans que nous nous étions quittés (on a compté) brusquement, et devant un simple bureau de tabac où il était entré s'acheter des clopes : quand il était
ressorti, je n'étais plus là, à l'attendre.
Et la vie
avait fait le reste. Ce jour, il avait repris contact par téléphone, grâce à une relation commune qui lui
avait donné mon numéro.
Au bout
de deux heures, installés face à face à une minuscule table de
bistro, ronde, comme si le monde se réduisait à présent à ce tout petit espace, un peu choqués l'un et l'autre, la sorte de conclusion à laquelle nous sommes parvenus a été celle-ci : - On ne nous a pas
fait de cadeaux, n'est-ce pas..., je lance, à la suite de son récit. Maintenant que tout ça est loin, bien loin, je voulais te dire que même si nous n'étions pas forcément destinés l'un à l'autre, je suis sûre que notre histoire aurait
pu être plus heureuse... - Oui, ils
nous ont fait payer le prix fort. Mais mon sentiment pour toi est resté intact. Cela, personne ne pouvait le prévoir. Mais j'en ai bavé.
À part ça, rien, ou pas grand-chose. Je suis rentrée chez moi, et lui est retourné à son boulot. J'ai repris la
ligne Concorde-Vincennes dans l'autre sens, à
six heures trente, heure de pointe, quand toutes les odeurs de corps, crasse, sueur et
harassement du travail, mélange de transpiration et parfums,
ont eu tôt fait de me faire oublier, cette fois définitivement je pense, celle de l'homme
qui sentait bon, que je venais de retrouver.
L'ai-je revu pour réparer quelque chose, me suis-je demandé, pour donner une explication... Était-ce bien la peine ? Je crois qu'il me rappellera. Et ça m'ennuiera. Comme par le passé, je ne saurai que dire et que faire.
Le soir,
au retour du métro, j'ai dû retirer de l'argent au distributeur, en me mettant sur la
pointe des pieds, cet appareil-là étant un peu trop haut pour moi pour bien voir l'écran, et en plaçant les mains en cornet autour
de mes yeux, à cause du reflet du soleil qui
m'empêchait de lire les consignes
sur l'écran, j'ai pensé Pourvu, pourvu que personne ne me
voie ainsi... en cette position de petite
vieille qui va chercher des sous...
Une voix
masculine dans mon dos me fit sursauter : Bonjour... Maadam... Et me retournant, après
avoir tiré sur les deux trois billets
que la machine était en train de cracher, je
vis Salman, mon ami Salman, qui sortait de la Poste et semblait tout réjoui de me trouver là.
Nous nous
sommes rendus, plutôt que de parler sur le
trottoir ensemble, au magasin B3 Bricolage, moi, pour m'acheter un très grand pot en terre cuite, lui se faire tailler des plaques de
verre. Terre versus verre...
Il avait
lu mon manuscrit et m'en parla avec vigueur, et sans faire de pause aucune. En
chemin, puis accoudé aux présentoirs du magasin, à la caisse, et enfin sur le
trajet du retour jusqu'à la maison... où il me raccompagna, moi, tenant sous le bras ses plaques de
verre à la découpe, et lui mon pot de terre gigantesque, le plus grand
que j'aie pu trouver au rayon jardinage.
Il était comme agité. Du manuscrit, il dit : - Il
ne faut pas que quelqu'un le lise, surtout pas... Parmi vos proches, mais pas
seulement... C'est un brûlot. Il y a dedans quelque
chose de scandaleux, qui peut faire beaucoup de dégâts, croyez-moi. Vous êtes dingue... (l'émotion, et l'éventuel danger, qu'il anticipait, lui donnant un vocabulaire inhabituel). Peut-être, je ne sais pas, je me dis, continua-t-il soudainement songeur, est-ce dû à la mise en parallèle de l'amour et de la mort... C'est l'interpénétration des deux qui fait
peur, et le fait aussi qu'il semble que vous n'ayez rien, absolument rien, changé à la réalité... On sent que tout est vrai,
vous avez seulement déroulé une histoire (malgré le titre que vous avez donné à ce texte : Pas d'histoire) devant le lecteur, médusé et terrifié, qui n'en peut mais... C'est une des possibilités. Parmi d'autres... Mais il n'y a pas que ça.
Il y a là aussi quelque chose d'obscène, sans qu'on sache vraiment quoi. Un conseil : détruisez au plus vite, ou plutôt,
car il ne faut détruire aucun écrit, ça porte malheur, mettez
bien de côté ce texte, en lieu sûr, à l'abri de toute lecture, y compris dans le disque dur de
votre ordinateur familial... afin qu'il ne tombe sous aucun regard... Je compte
sur vous, hein...
C'était une impression étrange que je ressentais
soudain. La même que dans mes rêves de la nuit les plus angoissants où quelqu'un à multiples figures me fait
reproche de plein de choses, que je ne comprends pas...
Je dis à mon ami, qui continuait de me mettre en garde, avec trop
de mots, trop de phrases, hachées, décousues, parfois égarées, semblant plongé lui-même dans une paranoïa démente, et dans lesquelles il revenait sans cesse à l'autocensure, que je devais selon lui pratiquer :
- Ah je
n'en peux plus !... Difficile de les tenir, ces grandes plaques... Elles
glissent sous mon bras... On n'échangerait pas, tous les deux
?... Le verre, contre le pot de terre... En plus, j'ai peur de me couper...
Mardi 4
juin
Le matin, je m'éveille avec une crainte
lancinante qui la veille déjà m'avait empêchée de me concentrer sur la lecture de La Fêlure (Scott Fitzgerald) : mon
manuscrit (si "explosif", donc, selon Salman), confié il y a deux semaines à Roger Grenier, ne risque-t-il
pas de revenir par la poste, après lecture (quinze jours, c'est
toujours le temps qu'il lui faut, à Roger, pour lire, et ce quel
que soit le nombre de pages fournies), alors que je serai partie en vacances et donc
absente pour le réceptionner, et éventuellement (ça, je n'ai pas encore décidé) le détruire selon le conseil (radical) de mon ami, soudain
"radicalisé" ? Excessif, en tout cas... Franchement, je ne le connaissais pas comme ça...
Plusieurs
fois la nuit, entre deux rêves, je me suis réveillée et ai ainsi pensé qu'il me faudrait à tout prix joindre Roger
Grenier afin de lui faire part de cette inquiétude...
Les pensées dérangées de la nuit sont souvent
affolantes. Et inutilement précipitées. Mais comment faire? Je n'ai même pas son adresse personnelle,
ni aucun téléphone où le contacter... Écrire alors chez Gallimard ? Ma lettre lui
parviendra-t-elle ? J'en doute fort... Et si elle lui parvient, comment
pourrai-je savoir s'il en a tenu compte ? Dès
que je me sens suffisamment calme et disponible pour le faire, me dis-je à 3h33, je téléphone aux éditions Gallimard. Je crois
savoir que Roger y a un bureau personnel.
"Effectivement,
il a", me dit-on au standard, le lendemain matin 10h. Je suis heureuse de
l'apprendre. "Mais il n'est pas encore arrivé".
Dommage. Je voulais lui parler là, tout de suite, maintenant...
Je m'apprête donc à le rappeler, "vers dix heures trente", me dit la
fille, nonchalamment et visiblement habituée à ce type-là d'appels.
Je me
sens déjà à moitié soulagée. Est-ce bien la peine ? Est-ce que ça vaut le coup de le déranger ? Que vais-je lui dire, d'abord ? C'est vrai, Salman, la veille, m'a fait un peu peur en me faisant
mettre le doigt sur une réalité que jusqu'à maintenant je n'avais que
vaguement abordée : on n'écrit pas pour ses proches, mais contre eux. Il faut sans
cesse se battre avec ça. Et si on écrit en pensant "aux siens", on n'écrit plus une seule ligne... Et si, encore, on dépasse ce cap-là (inhibant) et qu'on trouve le
moyen d'écrire malgré tout, quand cette écriture est devenue livre, il
faut anticiper, penser, prévoir les ravages qu'il peut
produire autour de soi, savoir si on est prêt
à payer le prix de ce qui sera
un jour forcément découvert, car on ne peut pas non plus cacher éternellement les choses, et on doit être, qui sait, alors en mesure de mettre en péril sa vie réelle, se retrouver seul,
abandonné de tous, comme pestiféré (bon sang! les rêves de la nuit reviennent !), ou alors, si pas abandonné, on se trouve soudain plongé dans un enfer familial et conjugal, profondément dévasté... Si, qui plus est, on n'a pas spécialement l'intention d'en rester à l'empilement de manuscrits dans le tiroir et que l'on sent
en soi un vague désir de les publier, on ne peut
pas faire l'économie de ces questions-là - inévitables. Et alors, on est
obligé de faire passer, même sans s'en rendre compte, la littérature avant la
vie, ou bien, carrément, renoncer à la littérature...
Moi, je
le dis tout de suite : Je renonce à la littérature !
Donc, concrètement.
1/ Cacher
les disquettes qui contiennent les textes dans une enveloppe fermée, à l'intitulé anonyme (le plus neutre possible, comme, par exemple, À reprendre, ou En cours...)
2/
Confier le texte ou les textes imprimés à Salman, qui lui a la manie de
tout planquer, alors qu'il est seul... Question d'histoire personnelle, ça. De vécu, à la fois dans l'amour et la terreur
des mots...
3/
Essayer de récupérer ceux envoyés chez Roger G. (tiens, Roger-gé...)
Voilà ce que je suis en train de me dire... quand le téléphone sonne (tiens, phone-sonne... est-ce que je ne serais pas en train de bredouiller, là ?)
- Allo ?
- Oui, c'est Roger. Roger Grenier...

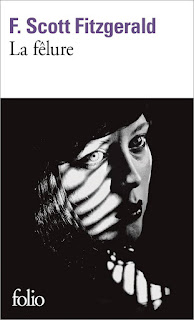



Commentaires
Enregistrer un commentaire